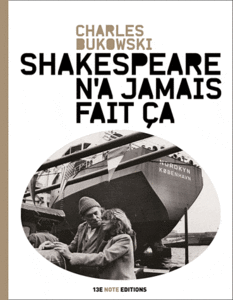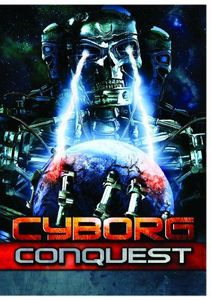A l'époque où je me refaisais l'intégrale de Twin Peaks, je faisais chaque nuit des rêves étranges où apparaissaient et disparaissaient sans logique des gens que j'avais croisé auparavant dans ma vie, parfois une heure, parfois deux ans, et, souvent, la figure de cette saloperie d'ex était là, et on discutait elle et moi et j'apprenais des tas de choses sur moi-même, comme cette capacité que je ne soupçonnais pas de l'envoyer balader, de l'insulter et de lui dire des choses que jamais je n'aurais pu dire dans la réalité. Dans ces rêves, je devenais le Staline de ma vie, un être de fer sûr de lui, qui ne faisait que ce qu'il entendait, sans compromis, bref, tout le contraire de ce que je suis dans la vraie vie, une fois le rêve terminé.
J'ai arrêté de regarder Twin Peaks et j'ai arrêté de me souvenir de mes rêves.
Mais l'autre nuit, voilà que mon esprit un peu détraqué me réserve une petite surprise. Ça reste assez flou, puisqu'il s'agit d'un rêve, mais j'ai le souvenir de tousser et de cracher deux boules violettes tenues entre elles par un amas de fils jaunes, et ma langue est pâteuse, j'ai du recracher un organe essentiel de mon tube digestif parce que je ne me sens pas très bien.

Et là, apparaît comme seule la magie des rêves le permet, Charles Bukowski. Il a effectivement le visage fracassé par les années et par l'alcool et par l'acné, il est petit, tassé, mais il est sobre parce que, je crois, même si je ne lui ai pas posé la question, qu'il a arrêté de boire.

Et nous discutons de tout, sauf de ses écrits, et la conversation est celle d'un père et de son fils. Oui, dans ce rêve, Bukowski est mon père, et ce n'est pas si perturbant que ça. Je lui dis que je suis heureux de le revoir, que ça faisait longtemps, et il me répond que oui, que ça fait dix-sept ans qu'il n'est pas venu. Il est assis sur un coin de la table, et je bois du vin, mais lui tourne à l'eau ou au café, je ne me souviens plus. Là-dessus je me réveille et tout est un peu vague.
Pourquoi rêver de Bukowski, alors que je n'ai pas une passion particulière pour lui et ses écrits ? A vrai dire, j'ai même la posture de celui qui déteste Bukowski, tout ça par esprit de contradiction, il faut bien le dire, car parfois il touche la grâce et le génie, mais c'est une autre histoire. Le fait est que j'ai eu la chance il y a peu de croiser Dan Fante, le fils de, et j'étais là en admiration devant ce petit homme un peu râblé, un peu taré, avec ses petits yeux encerclés par des petites lunettes rondes et rouges, et lui aussi avait arrêté de boire. Mon esprit a du effectuer un glissement entre la sobriété réelle de Fante et celle, rêvée de Bukowski. Mais merde, pourquoi Bukowski ?
L'avoir comme père serait une expérience dont on ne sortirait pas vraiment indemne, j'imagine que ramasser son père tous les matins dans le caniveau ne doit pas être une sensation très glorieuse, l'entendre hurler après un verre de vin doit vraiment être un triste spectacle, mais cet homme là possède un truc que peu de gens ont et qui fascine un petit con romantique comme moi : la capacité à creuser allègrement sa tombe et à se pelotonner dans la terre grouillant de vers, en tenant comme un trophée une bouteille de mauvais vin. Oui, c'est absurde et dégueulasse de voir ça comme un geste héroïque, mais voilà, j'ai besoin aujourd'hui de ce genre d'images pour me dire qu'il me reste de grandes choses à faire ici. Saloperie de rêve.

Mais l'apparition soudaine du bon vieux Hank dans mes rêves n'est pas simplement due à mes aspirations puériles, mais également à mes lectures récentes. Les excellentes éditions 13ème Note, spécialisées dans la littérature américaine en marge et hors circuit viennent d'avoir la très bonne idée de traduire pour la première fois en français les mémoires du vieux Charles, lorsque celui-ci a traversé l'océan, s'arrachant à son quotidien éthylique de Los Angeles et à sa tanière sécurisante, pour faire la promotion de ses bouquins et lire des poèmes en France et surtout en Allemagne, patrie de ses ancêtres (et lieu de naissance de Buk, d'ailleurs). Alors oui, on peut se dire qu'on trifouille les fonds de tiroirs pour se faire un petit nom et que si ce texte a été inédit en français pendant trente ans c'était peut-être volontaire et que ce n'est pas parce que le texte est signé Bukowski qu'il est bon, cela aurait pu être une immonde merde, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est du Bukowski, soit un type bourré de la première à la dernière page, qui jongle avec dextérité entre fond de trottoir et génie pur, le tout accompagné par de très nombreuses photographies signées Michael Monfort qui a suivi le vieux dégueulasse dans ses pérégrinations européennes où on le voit franchement abîmé, sorte d'épave naufragée, mais toujours soutenue par sa femme d'alors, Linda Lee, qu'on arrive quand même à plaindre parce que supporter Bukowski devait être, au quotidien, un exercice pas évident.
Bref, Buk est à Paris et se bourre la gueule chez Pivot, il n'a aucun souvenir de l'émission, à part qu'il voulait toucher les jambes d'une petite nénette assise en face de lui avant son trou noir. En Allemagne il fera moins de frasques et plus de tourisme, donnera une lecture à Hambourg où, une fois de plus, il insultera et se fera insulter, tentera de recroiser de vieux amis et rendra visite à de la vieille famille, mais, toujours, on est loin de l'émotion, peut-être parce que Charles ne savait pas comment l'écrire, si bien qu'on se dit qu'il manque quelque chose pour que le bouquin soit vraiment excellent. Encore une fois, on a du Bukowski entre la grâce et le pathétique. La grâce, on l'atteint en fait avec les quelques poèmes qui referment le livre. Et là, oui, on sait qu'on est face à un génie de la littérature, un type qui, une fois l'autobiographie de façade écroulée, nous donne à voir un artiste sensible qui sait dire des choses justes en utilisant des mots justes. Là, oui, c'est un réel, un vrai, un puissant bonheur.
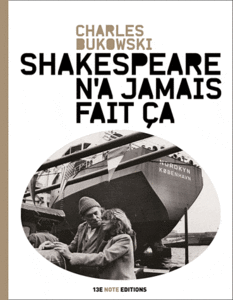
Reste le titre Shakespeare n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qu'il en sait le Buk ? Pourquoi s'imaginer Shakespeare en anglais austère écrivant ses pièces au fin fond de sa chambre de bonne entouré de cafards, à la lumière d'une bougie en fin de vie ? Je suis pour réécrire l'histoire de la littérature et, dans ce fantasme, je vois bien le bon William arpentant les pubs en bas de son quartier, à s'enfiler des pintes et se faire enfiler par ses acteurs, écrivant bourré et dépensant tout son argent dans des call boys de luxe, envoyant des lettres insultantes à la Reine, mais le courrier est intercepté par un des valets du roi, ancien amant de Willy, admirateur et assumant mal l'idée que son idole n'est qu'un pochard amer. Oui, en fait, Shakespeare, c'est Bukowski quelques siècles plus tôt, sortant des bars bourrés et pissant sur les carrosses, vomissant sur Big Ben et piquant une tête dans la Tamise pour se laver le matin. Je le vois faire une tournée promo en Allemagne, faire des lectures de poésie complètement pété, insultant et se battant avec son public, crevant l'œil d'une groupie pendant le coït, se faire tatouer JESUS IS MY SON sur la fesse droite et échanger une dose d'héro contre un bouquin dédicacé au dealer en bas de chez lui. William était une putain de rock star !

Mais je m'égare, et il vaut mieux laisser Hank conclure avec un extrait d'un de ses poèmes, un de ces trucs comme un jet de vomi, car avec Hank, contrairement à Shakespeare, il ne faut jamais s'attendre à des alexandrins et des sonnets :
je vais en Allemagne
pour
m'éloigner des champs de courses
et sortir de cette pièce.
Sherwood Anderson
sera du voyage je me souviens que ses livres
étaient ma nourriture
quand je n'avais pas de nourriture
on sera tous ensemble : moi
Sherwood, Ernie, Ezra et
Linda Lee
on va emmerder le pilote
et draguer l'hôtesse de l'air.